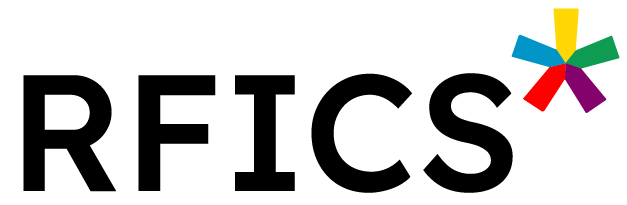C’était une première : le chapitre africain de l’International Network for Governmental Science Advice (INGSA-Africa), a organisé, en collaboration avec le RFICS, un webinaire en français. Il a eu pour sujet « le conseil scientifique et la résilience climatique en Afrique » ou comment promouvoir l’utilisation stratégique des connaissances scientifiques pour relever les défis climatiques en Afrique.
Présenté par la Dr Shaheen Motala Timol, présidente de l’INGSA-Africa et modéré par la Dre Justine Germo Nzweundji, biotechnologiste végétale et membre du comité de pilotage de l’INGSA-Africa, ce rendez-vous organisé le 2 septembre dernier a été l’occasion d’entendre deux chercheurs africains francophones, le Pr Kalulu Taba, professeur émérite de chimie de l’Université de Kinshasa et secrétaire exécutif de l’Académie congolaise des sciences (ACOS), et la Dre Victorine Ghislaine Nzino Munongo, socio-juriste, Chargée de recherche au Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation du Cameroun, et co-responsable de l’axe recherche du RFICS.
Après une brève présentation du RFICS par le Pr François Claveau, philosophe des sciences sociales, titulaire de la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique et responsable de l’axe de recherche du RFICS, le Pr Kalulu Taba est intervenu sur la question du conseil scientifique en lien avec les questions d’agriculture et de climat en République Démocratique du Congo. L’Académie congolaise des sciences est une jeune structure qui a été créée par dix scientifiques et officialisée en 2021. Elle a pour rôle d’émettre des avis fondés sur la science pour éclairer la décision politique. C’est notamment le cas en matière de résilience climatique. Elle cherche donc à renforcer sa collaboration avec les acteurs politiques et économiques et avec les forces vives du pays.
L’implication de l’État : une nécessité pour diffuser les approches scientifiques sur le terrain
Comme l’a expliqué le Pr Kalulu Taba, la République démocratique du Congo est un pays aux immenses ressources en forêts, en eau et en minerais stratégiques. Mais l’agriculture de subsistance domine (brûlis, itinérance, faible productivité, jachères de plus en plus courtes). Face à des émissions agricoles qui proviennent en majorité de la déforestation et de la dégradation des forêts, afin d’en tirer du bois de chauffe et du charbon, l’ACOS défend des approches « intelligentes » telles que les agricultures régénératives, biologiques, circulaires, les permacultures et surtout l’agroforesterie autour de Kinshasa. Sur le plateau de Bateke, autour de Kinshasa, des plantations d’Acacia ont été établies. Ces arbres ont une croissance rapide, ils fixent l’azote et procurent un charbon en quantité et de qualité. Ainsi, le système rotationnel permet de restaurer la fertilité, sécuriser l’énergie et réduire la pression sur les forêts.
Le Pr Kalulu Taba a toutefois précisé que, malgré le succès de ces techniques, elles ne sont pas répercutées sur l’ensemble du territoire. Il a déploré une faible implication de l’État soulignant que la plupart des initiatives proviennent des partenaires internationaux.
Ainsi, si les connaissances sont bien présentes, si les universités mènent les recherches, il manque un lien de connexion avec le terrain, les populations. Il plaide pour le développement de “champs‑écoles paysans” qui permettraient ainsi de diffuser les pratiques et de les faire adopter par les agriculteurs.
Institutionnaliser un conseil scientifique structuré pour en finir avec le relativisme décisionnel
À sa suite, la Dre Victorine Ghislaine Nzino Munongo a pris la parole pour parler de la structure, des opportunités et des défis du conseil scientifique sur les changements climatiques au Cameroun. Si le Cameroun, dispose d’un vivier de connaissances scientifiques sur l’environnement et le changement climatique, en revanche, celles-ci peinent à trouver leur place dans les décisions politiques, a-t-elle expliqué. Elle a ainsi souligné que la gouvernance environnementale camerounaise repose sur une diversité d’acteurs (politiques, scientifiques, citoyens, société civile et entreprises) mais que cette pluralité, en l’absence de coordination, engendre un relativisme décisionnel. Résultat : les savoirs scientifiques sont souvent considérés comme de simples opinions parmi d’autres.
Selon elle, plusieurs freins existent : l’absence d’une loi d’orientation de la recherche, une organisation nationale fragmentée, et une forte dépendance aux financements étrangers, qui modifient parfois les priorités locales. De plus, elle a regretté que les relations entre producteurs de savoirs et décideurs publics demeurent trop faibles pour assurer une circulation efficace de l’information scientifique.
La chercheuse a donc plaidé pour une approche transdisciplinaire, croisant savoirs scientifiques et empiriques, et a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes d’intégration, comme les évaluations d’impact environnemental, en y associant transparence, participation citoyenne et rigueur méthodologique. Un appel clair à institutionnaliser un conseil scientifique crédible et structuré.
Ce rendez-vous s’est terminé par une séance de questions et réponses au cours de laquelle le Pr Taba a insisté sur le passage de la théorie à la démonstration (projets concrets, policy briefs, champs‑écoles) tandis que la Dre Victorine Ghislaine Nzino Munongo a évoqué la faible coopération entre parties prenantes et la nécessité d’espaces d’intégration des recherches dans les décisions.