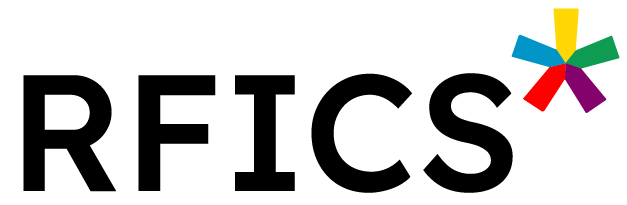Pour cette rentrée nous avons élaboré une nouvelle formule qui, au travers d’une entrevue, met en avant les points de vue d’experts du conseil scientifique venus de tous horizons…
Et quels horizons ! Le Dr Brice Tchakam Kamtchueng qui nous fait l’honneur d’être notre tout premier interlocuteur, évolue depuis de nombreuses années entre le Japon et l’Afrique. Maître de recherche à l’Institut de Recherches Géologiques et Minières (IRGM), affecté au Centre de Recherche sur l’Eau et Changements Climatiques (CRECC)*, il a répondu aux questions de Victorine Ghislaine Nzino Munongo, membre du comité exécutif du RFICS en tant que co-responsable de l’axe Recherche.
Dr Tchakam Kamtchueng, quel rôle devrait jouer un conseil scientifique dans l’orientation des politiques publiques en matière de gestion durable des ressources en eau, notamment dans un contexte marqué par les changements climatiques et les pressions anthropiques croissantes ?
Si nous prenons le cas d’un pays comme le Cameroun, riche en ressources en eau mais confronté à une insécurité hydrique paradoxale, un conseil scientifique doit jouer un rôle pivot entre la science et l’action publique. Son mandat ne peut se limiter à l’émission d’avis techniques : il doit contribuer à une lecture systémique et prospective des enjeux liés à l’eau dans un contexte de pressions multiples (croissance démographique, urbanisation anarchique, changement climatique, pollution et gestion des déchets, conflits d’usage, etc…).
Son rôle stratégique est de garantir que les politiques de gestion de l’eau reposent sur des preuves scientifiques solides (résultats probants de la recherche), alignées avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) ; notamment l’ODD 6 (eau propre et assainissement), l’ODD 13 (lutte contre les changements climatiques), et l’ODD 9 (industrie, innovation et infrastructure). Il s’agit également d’assurer la cohérence de ces politiques avec la Stratégie Nationale de Développement 2020–2030 (SND30) (document cadre de référence qui définit l’action de développement du Cameroun sur les questions socio-économiques et environnementales au cours de la décennie 20-30) qui fait de l’eau un levier transversal de l’industrialisation locale et de la transformation structurelle de l’économie.
Dans ce contexte, le conseil scientifique peut fournir des éléments d’aide à la décision, comme des analyses de vulnérabilité hydroclimatique, des modèles de scénarios territoriaux ou encore des recommandations pour la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) par bassin versant.
Ce rôle est d’autant plus crucial que la gouvernance de l’eau souffre de fragmentation institutionnelle. Le conseil scientifique devient alors un lieu de convergence intersectorielle, capable de faciliter le dialogue entre science, administration et société civile.
Comment garantir l’indépendance, la pluridisciplinarité et l’impact réel des travaux d’un conseil scientifique dans un environnement institutionnel où les décisions sont souvent dominées par des considérations politiques ou économiques ?
Garantir l’impact et l’indépendance d’un conseil scientifique suppose d’agir à plusieurs niveaux. D’abord, il est essentiel de définir un cadre juridique clair, indépendant, impartial et transparent pour le fonctionnement du conseil, afin de lui conférer une autonomie institutionnelle protégée de toute ingérence politique ou économique. Cette autonomie devrait être consolidée par une diversité des expertises dans la composition de ses membres (scientifiques de différentes disciplines par exemple hydrogéologues, économistes, sociologues, environnementalistes, urbanistes, représentants des usagers de l’eau, acteurs du secteur privé et membres d’ONG environnementales, etc..).
Ensuite, l’impact du conseil dépend de sa capacité à produire des avis clairs, accessibles, et opportuns. Cela implique de favoriser une communication transparente et efficace. La vulgarisation scientifique, la production de policy briefs stratégiques pour les décideurs, et la participation aux processus de planification sont des leviers essentiels. Ces travaux doivent intégrer les réalités locales tout en s’appuyant sur des standards internationaux.
Enfin, pour surmonter les résistances politiques ou économiques, il est fondamental que le conseil valorise des résultats concretsissus de ses recommandations et créer des mécanismes d’évaluation de son impact. Le dialogue régulier avec les ministères techniques, les communes et les bailleurs peut renforcer cette crédibilité.
Fort de votre expertise en hydrogéologie et en évaluation environnementale, quels types de données scientifiques devraient, selon vous, être systématiquement pris en compte par un conseil scientifique pour orienter les choix en matière d’aménagement du territoire ou d’infrastructures hydrauliques ?
Les projets hydrauliques et les choix d’aménagement doivent s’appuyer sur une base de données multidimensionnelles. Trois blocs de données apparaissent essentiels :
- Données hydrogéologiques et hydrologiques : niveau piézométrique, quantité d’eau disponible (recharge des nappes, débits saisonniers, dynamique d’écoulement, potentiel d’exploitation), qualité physico-chimique et microbiologique des eaux. Ces données sont cruciales pour évaluer la faisabilité des forages, barrages ou systèmes d’irrigation, et la modélisation des flux d’eau.
- Données environnementales et climatiques : cartographie des zones humides, données sur les écosystèmes aquatiques, indices de sécheresse ou de pluviométrie extrême. Ces éléments permettent d’intégrer les risques liés au changement climatique et à la perte de biodiversité.
- Données socioéconomiques et d’usages : démographie, usages agricoles, industriels et domestiques de l’eau, projections de croissance urbaine. Ces données permettent d’anticiper les pressions futures et de planifier des infrastructures inclusives.
Il est également crucial d’intégrer des données spatiales (SIG, télédétection) pour modéliser les dynamiques territoriales, et de croiser ces éléments avec des analyses coûts-bénéfices environnementaux et sociaux.
L’objectif ultime reste de promouvoir une planification territoriale intégrée, ancrée dans le Nexus Eau-Énergie-Alimentation-Environnement, au service d’une industrialisation endogène, résiliente et durable.
*Biographie
Le Dr Brice Tchakam Kamtchueng est maître de recherche à l’IRGM au Cameroun, spécialiste des ressources en eau au CRECC. Il est également Chef de Service à la DCST du MINRESI, au sein de la Cellule de la Coopération Internationale. Hydrogéologue, hydrochimiste et géotechnicien, il possède une expertise en hydrologie isotopique et en géosciences environnementales. Diplômé de l’Université de Yaoundé I, il a obtenu son doctorat au Japon grâce à une bourse JICA–JST (SATREPS–NyMo). Ses recherches portent sur l’évaluation des ressources en eaux de surface et souterraines au Cameroun, dans un contexte de changements climatiques et de pression démographique croissante, avec un intérêt particulier pour le comportement des éléments potentiellement toxiques (PHEs). Président de la Cameroon Academy of Young Scientists, il promeut le mentorat et l’engagement scientifique.